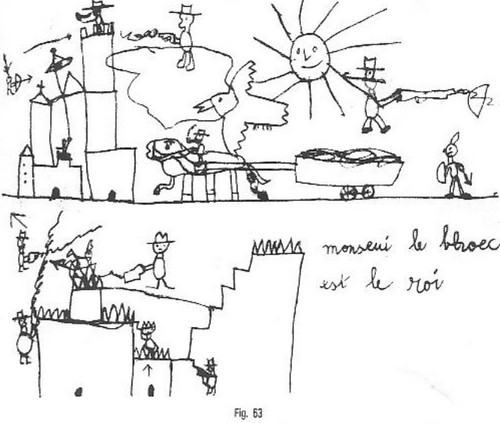J’avais l’intention de reprendre pour le bulletin des apprentissages, la discussion d’un schéma proposé à certains camarades. Mais, dès le début je me suis heurté à une question fondamentale. Certes, il est bon de savoir comment on entreprend tel ou tel apprentissage. Mais la question qu’il faut se poser auparavant, c’est : pourquoi l’entreprend-on ?
C’est une très grave question que j’aurais d’ailleurs ignorée si je n’avais fait mes expériences de l’été. Dans son livre « Psychologie sensible », Freinet soulignait le danger de la tendance unique hypertrophiée. Mieux valait, disait-il, tout un faisceau de tendances. Mais j’ai vu, de mes yeux vu, des gens qui n’avaient plus de tendance du tout et qui s’étaient abandonnés aux solutions ersatz.
« Dans « Absences répétées », la drogue est un épiphénomène. Elle est la manifestation moderne du mal de vivre et du mal à vivre qui forment une constante du romantisme – encore que les romantiques malades de leur siècle n’aient pas attendu la fin du XX* siècle pour recourir à l’alcool, au haschich ou à l’opium. Moins qu’à quêter le paradis, fût-il artificiel, François cherche à supprimer l’enfer : la drogue moins positive que négative, l’anesthésie contre le quotidien. François se drogue parce que le dégoût le pousse à s’absenter du monde.
Il est tristement évident que la drogue, loin de guérir ce dégoût, l’a renforcé. Se droguant parce qu’il voulait s’absenter du monde, François est de plus en plus absent au monde parce qu’il se drogue. Entre dégoût, absence et drogue, interaction en chaîne inévitable. Naufragé consenti, c’est, au vrai, un suicide étiré sur tout un hiver... »
Critique de film (Nouvel Observateur n° 413)
On peut savoir, intellectuellement, que de tels naufrages existent. On peut être informé. Mais quand il vous arrive d’en voir autant là, devant vos yeux à trois mètres comme nous en avons vu à Copenhague ! !
Cet été, également, j’ai su que d’autres vies ne tenaient qu’à un fil. Et ce fil fragile pourrait très bien casser. J’ai d’abord réagi avec effroi. Et puis, comme toujours, je me suis posé la question : que pouvons-nous faire ?
C’est cela, vous avez raison : proposons-leur nos solutions, ce qui nous a réussi, ce à quoi nous avons accepté de croire et ce par quoi nous avons accepté de nous laisser leurrer.
Peine perdue. Ils les dédaignent. Nous sommes d’ailleurs si loin d’eux qu’ils ne nous entendent même pas. Mais comment être auprès d’eux ?
Ce n’est pas là le problème. Comment faire pour qu’ils soient, eux, au plus près d’eux-mêmes ? Comment pourraient-ils naviguer au plus près de leurs brises ou de leurs tempêtes ? Mais pourquoi donc ont-ils été, si tôt, déportés sur des bateaux qui n’étaient pas les leurs.
Ce que je pense, essentiellement, c’est que, pour chaque homme, il y a un chemin (ou plusieurs) où il pourrait être tout à fait à l’aise.
L’image de l’hydre interne aux cent têtes prégnantes me revient. Elle s’est installée en nous au cours de notre enfance. Alors, il faut bien se soucier de nourrir chacune des têtes pour que, repue, satisfaite, elle lâche prise et laisse un peu plus libre.
Ou, si l’on préfère, il faut donner à chacun la chance de trouver son sillon profond. S’il trouve sa vraie route, alors il est sauvé. Il suivra son sillon jusqu’au bout en réalisant sa musique. Sinon, il retombera en dehors du disque et l’on n’entendra que des bruits déchirés. S’il trouve sa voie de réalisation, il aura devant lui un bon bout de chemin.
Car les sources d’une activité vraie sont inscrites profondément en creux dans l’enfance. Et il en faut du temps et des actes pour que les blessures se cicatrisent, pour que les marques s’effacent. Parfois, toute une vie.
Alors, je ne pense pas que ceux qui quittent le grand courant de la vie pour les mares croupissantes des solutions ersatz aient choisi librement cette voie. C’est que, probablement, tous les chemins ne leur avaient pas été offerts.
Ceci n’est pas rêverie ou déraison. Depuis quelques années, je suis sorti de mes propres encerclements. Et je puis observer les gens, je les vois, je les côtoie, je les sens, je les connais. Je les vois à la naissance de leur cours, au milieu et dans les si difficiles deltas du retour à la mer. Comme ils sont marqués ! Comme ça leur est difficile d’être autrement qu’ils ne sont. Ou, plutôt, comme elle est difficile en eux, la lutte de ce qui les habite si contradictoirement. Comme ils souffrent de ce qu’ils ont été « devenus ». Comme ils se heurtent à des murs lorsqu’ils essaient, d’eux-mêmes, devenir.
Car – et c’est peut-être très pessimiste – on a été fait ; on ne s’est pas fait. Pour recouvrer une certaine liberté ne faut-il pas d’abord se défaire ou plutôt se surfaire.
Mais plutôt que de jouer avec les mots revenons à la réalité. Par exemple à celle dont Bruno Bettelheim témoigne dans son livre « Les enfants du rêve ». D’après lui, suivant les conditions de l’éducation, on peut être un enfant d’objets, un enfant de personne(s), un enfant de groupe. Ou peut-être, un mélange avec dominante.
Des exemples ? L’enfant du kibboutz est un enfant de groupe. Les enfants de Saint-Gilles, fils de cultivateurs, sont des enfants d’objets. Et les quelques enfants de personne qui viennent d’y arriver de la ville font tache dans l’ensemble : ce sont des enfants d’ordre différent. Et toi, Maurice, si tu te sens un peu hors de tes terres avec les enfants de l’école, n’est-ce pas parce que tu es un enfant d’objets qui souffre des maths et des sciences refusées. Et toi également, Alain, qui as été élevé près d’un atelier de serrurier, comment ne serais-tu pas différent de nous, enfants de groupe.
Comment donc faire dans la société, et à l’école pour commencer, pour que chacun arrive au bout de son développement, à partir de ce que sa première enfance a fait de lui et sans en négliger les différents aspects contradictoires. Et en essayant d’assumer tous les aspects.
Aussi, vouloir, comme on le faisait autrefois, passer tout le monde au même moule, c’est complètement aberrant. Ou, alors, cela ne peut se concevoir que lorsque la société exige que l’on ne fournisse que des epsilons, sans tenir compte de leurs marques originelles et de leurs désirs personnels profonds. Lorsque nous voyons un adolescent accroché à quelque chose, est-ce que nous ne devrions pas nous réjouir. « Il est sur sa voie, il est peut-être sauvé de la veulerie, du laisser-aller, de l’abandon de soi, du désespoir. »
Mais presque toujours, dans notre société, ce n’est qu’à titre de hobby que l’on peut s’accrocher et être. Pour survivre, on est obligé de consentir à un travail social. Et l’on ne peut commencer à vivre vraiment qu’en dehors de ce travail.
—Mais il faut dire que, la plupart du temps, dans notre société, le travail social consenti est tellement aliénant qu’il n’y a plus de place pour une autre vie, pour sa vraie vie.
—Il arrive parfois, cependant, qu’il puisse y avoir coïncidence entre le travail social et le besoin profond.
C’est ce qui se produit, par exemple, dans l’enseignement, – quand un minimum de bonnes conditions de travail se trouvent réunies. – Dans ce même ordre d’idées, quelqu’un qui a hérité, de son enfance, de la passion des chiffres ou de celle de l’argent peut être un comptable ou un trésorier heureux.
Celui qui a hérité d’une passion de classement et de connaissance peut être un bibliothécaire heureux. Quelqu’un qui a été frustré socialement peut se réjouir d’un poste de direction, si petit soit-il. Beaucoup de ceux qui ont été traumatisés dans leur enfance par la blessure ou la mort d’un proche parent peuvent trouver leur voie dans la médecine. Une enfance peuplée d’animaux peut se résoudre heureusement dans une carrière de vétérinaire ou d’éleveur. Ou de braconnier s’il s’y est ajouté des difficultés de relation avec le père.
On peut trouver cent autres exemples à l’appui. Écoutez : il y a une vie à vivre. C’est inscrit dans le livre de celui qui naît. Faut-il qu’il la vive ? Si la réponse est oui, comment peut-on l’aider à la vivre au mieux dans le présent et l’avenir.
Mais comment l’individu pourra-t-il se placer dans la ligne des éléments de sa personnalité ? Et comment les aura-t-il vécus suffisamment positivement, à l’école par exemple – ou au moins à l’école – pour qu’il n’en soit pas dépassé au point qu’il n’ait plus d’autre issue que la folie, la mort, ou les activités suicidaires telles que la drogue ou le banditisme ?
Quelle réponse peut-on apporter ? Est-ce qu’il ne faudrait pas que chacun puisse, à l’école, élucider ses hypothèses de vie, découvrir ses domaines de réalisation, manifester ses composantes. Et aussi trouver un équilibre suffisant pour ne pas étouffer de souffrance.
N’est-ce pas en ces termes que le problème de l’activité créatrice, de toute l’activité humaine devrait être posé ?
Alors quelles circonstances allons-nous donner, quels camarades, quels groupes, quels maîtres, quels chemins, quels enthousiasmes.
Si comme le veut une certaine autogestion, l’enfant est « libre » de son choix, il va passer à côté. Pourquoi choisirait-il telle activité ? Pourquoi ne la choisirait-il pas ?
Commençons par nous intéresser à cette dernière question.
Ce peut être :
– par manque de matériel, de place, d’outils, d’idée, d’exemples, d’un minimum d’aide,
– ou par inertie, par prévention, par conditionnement, parce que la tête de l’initiateur ne lui revient pas, parce que c’est réservé aux bourgeois...
– ou par insuffisance physique ou physiologique (le volley-ball, le basket pour les petits, les courses de chevaux pour les grands),
– parce qu’on a eu des échecs, des mauvais apprentissages, des maladresses,
– parce qu’on manque des bases minimales.
Mais, plutôt que d’aligner des suites de mots, descendons dans le détail. Rapprochons-nous de la vie réelle pour voir les choses de près. Et, pour commencer, de notre vie.
Pourquoi nous, toi, moi, lui, avons-nous ou non fait du cheval, de la trompette, du piano, des poèmes, écrit des articles, cultivé notre jardin, été radioamateur, bricoleur, guitariste, collectionneur de fossiles, spéléologue, alpiniste, photographe. Bref, pourquoi sommes-nous dans tout ce que nous sommes. Et pourquoi ne sommes-nous pas où nous ne sommes ?
(à suivre)
Paul Le Bohec
Article paru dans l’éducateur n°12, 1er mars 1973, p.7-8