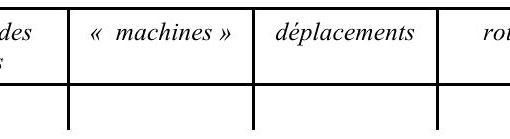À mon avis, il ne semble pas possible de voir clair dans un projet d’éducation populaire si on ne se pose pas les questions fondamentales. Par exemple, comment apprendre juste à lire si on ne sait pas pourquoi on le fait, ni à quoi cela correspond fondamentalement ?
C’est pour cette raison qu’avec quelques camarades, je commence à me poser la question de savoir « ce que cherche l’être humain ».
1. Pour certains, l’être humain n’est qu’un transformateur d’énergie solaire. On pourrait souscrire à cette idée et avoir seulement, comme les philosophes orientaux, l’unique passion de « l’intelligence de la vie ». Mais, pour cela, il faudrait accepter de n’être qu’une goutte d’eau dans le fleuve du temps. Il faudrait faire face à la mort et l’attendre tranquillement. C’est d’ailleurs une fausse mort puisqu’on remonte à des milliards d’années et qu’on continuera après nous.
La plupart du temps, dans notre civilisation du moins, nous nous résolvons difficilement à cette philosophie. La négation de la mort par le symbolisme est d’ailleurs une constante des cultures humaines.
L’être humain cherche à manifester, à éprouver, à se prouver son existence en vivant au plus grand possible. Sans que personne ne sache vraiment ce qu’est ce plus grand. Comme le pense Freinet (et Adler), l’être cherche à augmenter, à réaliser, au maximum, son potentiel de puissance.
Pour Laborit qui résume en deux mots les désirs de l’homme : SURVIVRE et PROCRÉER, il consacre l’essentiel de son temps à essayer d’assurer sa dominance.
Il y a là un premier problème à considérer. La référence de Freinet au grain de blé est-elle juste pour l’homme. N’est-ce pas tomber dans le biologisme ? Pour Marx, par exemple : « L’essence de l’homme, ce sont les rapports sociaux. »
D’autre part, dès l’enfance, l’être baigne dans le mode de production capitaliste. Et ses désirs de réalisations sont des désirs d’homme capitaliste.
« Au départ, il y avait le matériau brut : « l’homo sapiens ». Et ce matériau a été travaillé par le mode de production capitaliste jusque dans ses désirs. » (Mendel, « Pour une autre société »)
Et il l’est encore (publicité, appareil idéologique de l’État, école, famille). Nous devons continuer à poser sur l’activité enfantine la grille de Freinet qui permet de comprendre le comportement de l’être humain face aux problèmes de la vie (famille, religion, école, métier, etc.). Voir le travail sur les biographies.
2. Actuellement, l’être veut exister, il veut être reconnu. Il a besoin de parler de lui, de ses intentions, de ses rêves, de ses évènements, même microscopiques. Il veut être entendu, il en a absolument besoin : c’est une constante de sa vie : le besoin de communication est peut-être constitutif de l’être humain.
La pédagogie doit tenir compte de cette demande formidable d’expression, de manifestation de soi. Il faut organiser les lieux de parole, les lieux et les modes d’expression. Que d’abord, dans un premier temps, l’être puisse projeter au dehors ce qui le charge. Peut-être pour mieux le percevoir, pour mieux se l’approprier, se l’assimiler.
Mais est-ce qu’il ne faut pas distinguer la parole superficielle de la parole profonde ? La première étant essentiellement du bavardage, une communication, une expectoration d’information, souvent à la cantonade, sans qu’il y ait vraiment besoin de quelqu’un pour entendre. La parole profonde étant quelque chose qui cherche à monter, depuis de longues années peut-être et qui attend un climat favorable et une écoute, multiple si possible, pour s’exprimer.
3. Mais face à la peur de ne pas réussir à se faire sa place, à « exister » face au monde qui ne se soucie pas de lui, face à l’angoisse de la mort, du non-être, il a besoin d’alliés.
Et il a besoin d’être aimé. (Qu’est-ce que cela veut dire ?)
Les alliés, les accueillants, les écoutants peuvent être des individus et/ou des groupes.
Il nous faut approfondir notre perception des groupes, connaître leur importance, leur efficacité, ce que les individus en attendent...
Mais aussi s’intéresser aux phénomènes de pouvoir social, institutionnel, d’autogestion.
« Et si l’individu « n’existait » que dans les groupes ? »
Nous avons à explorer les modes de prises de conscience des déterminants de l’être. Et ça peut être aussi le travail de l’école (dès le premier cycle du second degré).
4. L’être a besoin d’éprouver le maximum de jouissances, ce qui peut, peut-être, l’entraîner vers un maximum d’animalité.
Mais c’est beaucoup plus complexe que cela. Car il peut y avoir des transpositions symboliques. D’ailleurs les jouissances peuvent naître d’une contradiction : il y a une dialectique de la jouissance. Elles peuvent se fonder essentiellement sur un effacement des frustrations de l’enfance ou sur la recherche, la redécouverte, la reprise des gratifications de l’enfance.
Cela serait à approfondir. Il faudrait observer les comportements infantiles qui se manifestent sous une forme symbolique plus ou moins décodable. Non seulement au niveau des enfants, mais à notre propre niveau. L’école pourrait être le lieu de la parole symbolisée et peut-être même, dans certains cas, le lieu de la parole directe.
5. Mais ce que l’être humain cherche surtout, ne serait-ce pas, avec la survie – c’est-à-dire « le maintien en état de fonctionnement du système auto-organisationnel » (Laborit) – à vivre le plus pleinement possible sa sexualité (procréer) ?
Ouais, sa sexualité d’homme capitaliste : appropriation, possession de l’autre, valeur d’usage, etc.
Oui, oui, nous verrons ça aussi. Mais il faut que nous partions de notre expérience d’éducateur et de nous-mêmes. Il faut qu’il y ait un constant aller et retour entre nos compréhensions progressives et nos actions pédagogiques qui peuvent s’en trouver remodelées.
Personnellement je poursuis régulièrement une enquête auprès des jeunes qui acceptent davantage de se livrer à ce sujet. Et il me semble pouvoir dégager trois points principaux.
a) L’être cherche à vivre intensément et pas seulement sur la marge de lui-même. Il cherche à flirter avec les limites, à aller « jusqu’au point de se perdre » (voir Georges Bataille : « L’érotisme »). Et c’est souvent une des caractéristiques de l’érotisme : le danger, la présence de la mort réelle ou symbolique.
Et il se peut que, dans la vie, beaucoup d’actions de ce type soient dérivées de cette recherche. Tout cela ne s’appelle-t-il pas le dépassement, l’aventure.
S’il n’y a pas d’aventure, on s’ennuie.
Il y avait principalement l’aventure sexuelle qui se nourrissait souvent d’un piment de danger, d’un risque de perte sur le plan affectif ou social (scandales, drames). Est-ce que cela ne subsisterait pas encore un peu ?
Et peut-être qu’à partir de là se développent toutes les activités qui font également approcher des limites, qui font courir des risques extrêmes. Pensez aux joies que procurent : l’alpinisme, la voile dans la tempête, les expéditions, le cyclisme, la moto, la voiture, le parachutisme, le sport, la recherche scientifique et technique. Mais aussi la confidence littéraire, l’aventure poétique, l’engagement syndical ou politique, l’engagement théâtral...
Et même s’il faut flirter plus près encore de la mort (physique : drogue forte, banditisme ; sociale : cambriolage, fraude, vol), tout semble préférable à la vie quotidienne, à la vie banale où tout est pareil chaque jour, où on vit végétativement.
Cela rejoint la notion de pouvoir. Évidemment, prise de pouvoir sur l’élément physique, sur les éléments naturels. Mais surtout : prise de pouvoir sur soi : se mettre à l’épreuve, se connaître dans la difficulté, s’éprouver.
Mais aussi : pouvoir social institutionnel avec les risques que l’on court de ne pas être aimé par l’autorité. Pour Mendel, le plaisir maximal, c’est le pouvoir obtenu par sa classe institutionnelle.
Et ce sera l’essentiel du socialisme qui ne devra pas répondre à la production exclusive de valeurs d’usage (précapitalisme), ni à celle de produits « socialement » utiles (capitalisme).
« La logique du mode de production socialiste est celle de la production-réalisation des besoins humains de notre époque, lesquels sont, en dernière analyse, les besoins d’exercice du pouvoir collectif dans les rapports de production et les rapports sociaux. »
Dans certains lieux pédagogiques, cet apprentissage est déjà commencé.
b) Deuxième élément de la sexualité.
Il y a un autre élément de cette notion d’engagement total (vivre au plein). Et cela nourrit encore plus le pouvoir.
Je veux parler de notre soif de connaître la sexualité de l’autre, la sexualité des autres. Si cela n’existait pas, les romans, les films érotiques, les revues porno n’auraient pas cet attrait pour des quantités de gens, dont nous sommes.
On pourrait dire qu’on s’en lasse vite, qu’il suffit une fois ou deux de connaître ce qui avait été si longtemps interdit pour trouver l’apaisement, le calme, la tranquillité. Mais ça revient et, dans la vie quotidienne, il y a une sorte de permanence de cette curiosité des autres, des actes des autres, des corps des autres.
Il y a là une demande extraordinairement troublante de prise de pouvoir par la connaissance de l’autre. (Si possible secrète : voir le trouble voyeurisme).
C’est peut-être pour cela que tant de gens craignent les psychologues qui « sauraient » décoder les signes d’eux qui leur échappent, malgré leur vigilance.
Mais dans ce second élément n’y a-t-il pas également des possibilités de sublimations (dans la connaissance et autres) ?
En effet, il peut y avoir une jouissance extrême à surprendre les secrets de la nature, à étudier le comportement des animaux, des électrons, des volcans, des groupes sociaux (ethnologie), à piéger les ombres et les couleurs (photo), le mouvement (cinéma), les structures (mathématiques, sociologie, économie politique...), tout ce qui est caché et qui ne se découvre que par un engagement extrême d’observation et de compréhension. Pour enfin réussir à PERCER LE VOILE.
On voit tout de suite quel rôle peut jouer l’école à ce niveau. Car toutes les pulsions profondes ne peuvent être vécues dans la réalité. L’école peut aider à la participation aux « bénéfices secondaires du refoulement ». (Freud)
Mais elle peut accentuer encore plus ses effets. Elle peut aider chacun à se donner à connaître à lui-même, à prendre sous son propre regard lui-même et son environnement. Ce qui permettra une meilleure prise de conscience de ses propres déterminants familiaux, sociaux, politiques, idéologiques. En fait la recherche sur soi et l’étude de ses relations au monde peut être le noyau initial d’une immense culture. Si les chemins n’en sont pas bloqués.
Mais on pourrait aller plus loin. Et c’est peut-être cela qu’il y a aussi dans le verbe aimer. Aimer, c’est accepter de se donner à lire. Et même aider l’autre à vous lire. Car il y a également et contradictoirement, une jouissance à se donner à connaître. Mais il faut être en sécurité suffisante et faire un pari positif sur la non-utilisation par l’autre de la connaissance de vous qu’il aura acquise.
Cela a l’air gratuit. Mais ce sont là les tactiques de l’expression libre qui se fondent, peut-être, sur un désir profond de se donner à connaître dans sa vérité nue. On ne cherche peut-être pas à communiquer, mais à « se » communiquer. À se communiquer, soi.
L’être humain reste au niveau de sécurité inférieur tant qu’il n’est pas assuré de pouvoir faire, sans danger, un pas de plus vers une expression plus totale, plus vraie. Qu’est-ce que quelqu’un qui s’engage sinon quelqu’un qui s’engage dans un dévoilement, un dénudement de soi ? C’est pour cela que l’on utilise souvent, pour faire sourdre sa parole vraie, des symboles de plus en plus transparents.
Il suffit d’ailleurs pour se rendre compte de cette montée de la parole vraie de suivre – comme on l’a déjà fait – des séries d’expressions libres.
Et aussi, de se regarder soi, dans ses désirs de communication « au plus clair » de sa parole sexuelle propre.
c) La régression : troisième élément de la sexualité.
J’ai beaucoup appris, par des conversations engagées, des comportements amoureux des êtres. Et le désir d’être lavé, ou de laver, de posséder des nounours, de jouer avec, de bêtifier, d’être grondé, d’être battu même, d’être bercé, d’être pris dans les bras, de sucer son pouce, tout cela me fait penser que l’être cherche à régresser, à progresser par retour à... et dépassement de l’enfance.
C’est comme s’il cherchait à revivre différemment ce qu’il a mal vécu, en substitution ou en effacement (de ses culpabilités ancrées). Et également, comme s’il cherchait à revivre tout ce qu’il a bien vécu, tout ce qui a été gratifiant.
Beaucoup de militantismes ne sont-ils pas des tentatives de revivre sa vie dans les autres pour qu’ils ne connaissent pas ce que nous avons connu, pour qu’ils en soient protégés ? Ce serait une façon de refaire sa vie.
En ce qui concerne la régression, la réussite d’un couple ne vient-elle pas, entre autres, de l’aide réciproque à revenir, en toute sécurité, à des stades enfantins ? Ne serait-ce qu’au niveau de la parole enfantine si fortement corsetée, réprimée, refoulée qu’elle a été, pour ainsi dire, renfoncée dans la gorge.
Mais tout ce rattrapage ou cette reviviscence nécessaire peut être l’objet de transpositions symboliques. Il y a, pour les différents éléments de la sexualité, le miracle de la sublimation dont se nourrit l’humanité. Et si nous voulons voir clair dans ce que nous faisons, il faut la prendre en compte. Il suffit peut-être d’accepter de regarder.
Mais nous venons de toucher du doigt la question du pouvoir exercé sur l’enfant. Et de sa résistance continue. Et de ses tactiques, parfois extrêmes (mutisme, anorexie, mort) pour résister à la pression des individus et des groupes. Il lui faut toujours céder.
Il faut l’aider à ce que son renoncement ne soit pas définitif. Non seulement en lui permettant des expressions, des conduites symboliques de défense, mais une première inscription de son autonomie dans la réalité.
Évidemment, si l’on voulait être complet, il faudrait à propos de ce que cherche l’être humain, parler également de sa recherche de la connaissance et de la dominance par les mains, par les sens, par l’action, par l’émission et le tâtonnement d’hypothèses, par l’imitation, le vécu collectif, le travail...
Mais j’ai voulu simplement développer quelques idées plus rarement admises. Pour avoir des retombées.
Évidemment, tout ceci serait à réécrire, collectivement. Ce n’est pas très clair. Mais c’est mieux ainsi. C’est à chacun de décider de voir clair pour lui-même et avec les autres.
En résumé, est-ce que nous ne devons pas, à l’école, permettre d’abord à chacun un premier stade d’expression et de réalisation symbolique de tout le refoulé ? Avec l’aide des alliés naturels, c’est-à-dire de ceux qui ont partagé son expérience de l’oppression, de l’obligation à intégrer, dès les premières heures de vie, les normes, les commandements de la société et de l’état capitalistes.
Ensuite nous devons favoriser une prise de conscience, une analyse.
Et enfin une action, une lutte pour obtenir tout le pouvoir social auquel chacun a droit avec sa classe institutionnelle.
P.S. – Je viens de lire un bouquin important : « L’unité de l’homme » (colloque de Royaumont) (1). J’y trouve ceci sous la plume d’une sommité scientifique :
« L’originalité de l’animal humain est en effet plus grande : homo est à la fois “sapiens-demens” et cette originalité est liée à sa complexité. La très haute complexité humaine que j’appelle hyper complexité tient précisément dans la dialectique, l’instabilité, à la limite l’incertitude entre ce qui dans l’homme est SAPIENS et ce qui est DÉMENS.
Or je suis persuadé, à la suite d’Ange et de Monod, qu’il faut considérer l’univers des idées, idéologies, mythes, dieux issus de nos cerveaux comme des “existants”, des êtres objectifs doués d’un pouvoir d’auto-organisation et d’auto-reproduction, obéissant à des principes que nous ne connaissons pas et vivant dans des relations de symbiose, de parasitisme mutuel et d’exploitation mutuelle ou non. »
Attention, c’est un scientifique objectif qui écrit cela. Ça devrait nous faire réfléchir. Est-ce que les passionnés de créativité (enfantine-adulte) n’agissent pas « sainement » pour le bon fonctionnement du cerveau et de l’être ? Quand on accède à son délire, on peut l’accepter comme partie de soi et en jouir – et accepter d’en jouir –. Et l’utiliser.
Et accepter de comprendre celui des autres (enfants, adultes) au lieu de chercher à le réprimer à toute force.
Paul Le Bohec, Parthenay-de-Bretagne
Texte paru dans l’éducateur N°11, 30 mars 1977, p.29-31
(1) Il y a 33 ans, à l'initiative d'Edgar Morin, se tenait un grand colloque international sur « L'unité de l'homme ». Son but : promouvoir une anthropologie fondamentale reliant les données de la théorie de l'évolution, de l'éthologie et les études sur le cerveau aux sciences humaines. Un programme encore à l'ordre du jour...
Royaumont, septembre 1972. Dans une abbaye du XIIIe siècle de l'Île-de-France, pendant trois jours, une trentaine d'orateurs et quelques dizaines de participants sont assemblés. Le titre de la réunion, « L'unité de l'homme », peut, à première vue, passer pour une proclamation humaniste conforme à la vocation spirituelle et religieuse de l'endroit. Mais c'est le sous-titre qui donne la clé : « Invariants biologiques et universaux culturels ». Parmi les organisateurs, on compte trois prix Nobel de médecine. Mais il ne s'agit pas d'un colloque de médecins ou de biologistes ni d'une de ces réunions dont le prestige et la légitimité sont proportionnels à la spécialisation. Aux côtés des biologistes moléculaires Jacques Monod, François Jacob et Salvador Luria, figure Edgar Morin et, dans la salle, outre le (jeune) neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, on trouve quelques-uns des plus grands noms des sciences humaines : l'anthropologue Maurice Godelier, l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie, le psychologue social Serge Moscovici et d'autres chercheurs à la réputation établie ou montante (le psychologue Jacques Mehler, l'anthropologue Dan Sperber).
Claude Fischler, « L'unité de l'homme », retour sur un colloque fondateur, in Les grands dossiers de Sciences Humaines n°1, décembre 2005.