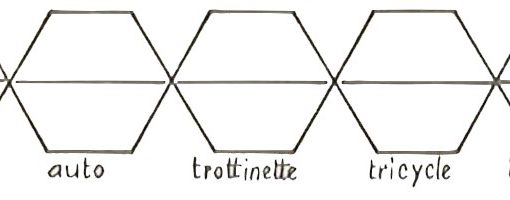Paul – Écoute Hervé ! À peine viens-tu d’arriver que déjà, tu te prépares à m’attaquer.
Hervé – Mais non, qui parle de t’attaquer ? Non, j’aimerais seulement t’aider à prendre conscience. Mais tu recules au moindre mot, de crainte d’avoir à te remettre en question.
P. – Tu es bon, toi. Tu en veux à mon militantisme. Et tu crois que je peux, comme cela effacer, sans difficultés, trente années de ma vie et me retrouver soudain neuf comme un poulain de 10 jours. Tu dis qu’il ne faut pas être militant. Et moi qui n’ai été que cela toute ma vie, tu voudrais que j’accepte et que j’oublie. À vrai dire tu me rends malade, physiquement.
H.– Et pourtant, j’en suis convaincu, il ne faut pas être militant. En fait, le militant lutte pour imposer des idées. Il essaie de dominer les autres. Et pas toujours après avoir pleinement réfléchi sur la valeur de ces idées mais souvent pour le seul plaisir de la lutte.
P.– Oui. Mais ne te rends-tu pas compte que, si je n’avais pas été militant, tu m’aurais reproché mon indifférence au monde et aux événements : ce que font peut-être d’ailleurs d’autres fils à l’égard de leur père. Car au fond, ce que vous cherchez, ce n’est que la contestation de vos pères.
H.– Ne me fais pas rire. Tu crois vraiment que je ne pense pas ce que je dis. Pour moi, le militantisme est néfaste parce qu’il essaie d’agir et il provoque l’opposition. Pourquoi, si votre idée était si bonne, les instituteurs de France ne l’ont-ils pas adoptée d’emblée alors que vous vous êtes donné tant de mal ?
P.– Peut-être parce qu’ils ne voulaient pas se donner de mal.
H.– Ne te dérobe pas en faisant de l’esprit. Vous avez voulu convaincre. Et vous avez provoqué aussitôt la résistance. Votre action a déclenché une réaction équivalente.
P.– Alors, il fallait tout accepter ? Tout était bien, tout était parfait. Il n’y avait plus qu’à s’allonger sur une chaise longue et se réjouir béatement de ce que le monde soit si bien fait.
H.– Mais qui te dit cela ? Bien sûr que la société est à transformer. Mais le militantisme forcené n’était pas forcément ni la seule, ni la meilleure solution. Ce qu’il faut d’abord, à mon point de vue, c’est se transformer soi-même, c’est être. Or toi, tu n’es pas, parce que tu n’es pas créateur. Où sont tes œuvres ? Montre-moi tes poèmes, tes peintures, tes réalisations. Non, rien, parce que tu n’as jamais été vraiment toi-même. Au lieu de commencer par faire, à ton niveau, la révolution, tu as toujours vécu en dehors de toi.
P.– C’est un peu fort ! Tu crois que je n’aurais pas préféré, comme tant d’autres, rester dans ma classe, après cinq heures, pour bichonner mon travail et prendre mon plaisir personnel au lieu d’écrire tout ce que j’ai pu écrire ?
H.– Eh ! bien, c’est justement ce que je te reproche. Tu n’as pas vécu parce que tu n’as été qu’un intellectuel.
P.– Et comment pouvais-je faire autrement ? Est-ce que j’avais le choix ? Mon désir irrépressible, né peut-être de ma propre enfance, c’était de refuser d’accepter les conditions qui étaient faites aux enfants, cette répression, ce matraquage psychologique, ce gavage, cet assassinat des talents et des êtres.
Or, l’Éducation Nationale était tellement hiérarchisée que, si l’on voulait changer quelque chose, il fallait d’abord toucher les « gens d’en haut ». Et, puisque je voulais agir sur les maîtres du destin de l’enfance, il fallait que j’accepte les conditions objectives et que je tienne compte du super intellectualisme des maîtres de l’Université. Et pour pouvoir les atteindre sur le plan de la raison, il fallait bien que je sonde intellectuellement les choses et que je m’efforce de parler leur langage.
H.– Oui, mais ce n’était peut-être pas la seule voie.
P.– Non, bien sûr. Mais d’autres camarades, mieux armés que moi, occupaient d’autres postes de combat. Et moi, c’était celui-là qui m’attirait parce que j’étais ainsi fait.
H.– Malgré tout, c’était la mauvaise voie. Comment veux-tu que ces intellectuels puissent entendre ta toute petite voix d’instituteur, ta voix de fausset ?
P.– Évidemment, la partie était presque perdue d’avance. Mais je suis lutteur. Et ce n’était pas parce que la partie était difficile que j’allais y renoncer. Et c’était d’ailleurs pour cette raison que nous nous étions constitués en famille. Le combat que menait Freinet nous tentait parce que nous pensions que nous devions le mener. Est-ce que Freinet avait renoncé, lui, malgré les difficultés incomparables qu’il avait rencontrées ? Les buts de sa lutte nous convenaient. Et nous nous étions intégrés pour cela à son équipe.
H.– Au fond, peut-être, ce qui vous unissait, ce n’était pas tellement le but à atteindre, mais le plaisir de lutter ensemble.
P.– Tu es dur. Et pourtant, il y a un peu de cela. Nous nous sentions isolés au fond de nos campagnes avec, au cœur, une flamme suffisamment forte pour nous donner le désir de sortir de nos routines et de nos acceptations. Et quand nous avons rencontré des frères, nous nous sommes sentis heureux d’être des hommes en marche et de n’être plus seuls. Personnellement, j’avais vite compris que, seuls, les intellectuels qui étaient aussi restés des hommes auraient pu accepter de nous entendre. Et, il faut bien le dire, cette espèce de grands intellectuels tend à disparaître. Le jeu donc n’en valait pas la chandelle. Aussi je me suis retourné vers mes camarades avec qui j’étais si bien et qui, au fond, étant les seuls praticiens, avaient seuls de l’importance.
H.– Eh ! bien, c’est justement : vous avez été heureux ensemble. Vous avez constitué une famille. Et vous vous êtes séparés des autres. Et les autres vous en ont voulu et ils ont délimité votre communauté pour l’enfermer dans un ghetto.
P.– Mais il a fallu le terrible bouleversement de mai pour qu’autre chose soit possible et soit même envisageable. Au fond, tout le monde souffrait de la situation. Nous étions simplement des gens qui la ressentions plus durement parce que nous étions plus fragiles. Nous étions peut-être aussi des gens qui avaient eu de la chance de sortir de leur solitude. Je l’ai découvert avec étonnement. J’allais à tous les congrès parce que je pouvais y retrouver des frères. Et j’avais même de très proches amis au Canada. Et je ne savais pas qu’à cinq kilomètres de chez moi, je pouvais aussi en trouver. Reuge me disait qu’il en avait dans sa propre école et il ne le savait pas. Il a fallu le profond bouleversement de mai, la prise de la parole, pour que cela apparaisse clairement aux yeux de tous.
Mais tu me reproches mon manque de création : il y a tout de même mon arbre à ressort, tu sais, mes schémas.
H. – Oui, c’est bien. Tu as créé quelque chose à ton usage. Mais à partir du moment où tu veux l’imposer aux autres, c’est néfaste.
P.– Mais, je ne veux pas du tout l’imposer aux autres. Je le propose seulement. Tu sais, c’est toujours comme cela que nous avons toujours avancé à l’école Moderne. Ce que chacun de nous trouve, il le donne aux autres. Et chacun accepte ce qu’il veut. On travaille en copains et on bénéficie des efforts de tous. Maintenant que la parole est possible, c’est clair pour nous, Il nous suffira de continuer, sans chercher à imposer nos idées. Nous nous contenterons de les présenter, à l’occasion. Si elles sont fortes, elles seront acceptées.
H.– Les efforts de tous ! Mais, justement, il ne faut pas faire d’efforts. Si tu fais des efforts, c’est que tu as un but. Il ne faut pas de but. Il suffit d’être, à tout moment de la vie. Le but c’est d’être soi, de faire face au présent, continuellement. Et c’est peut-être, dans l’enseignement, la pédagogie Freinet, qui le permet tout particulièrement. Mais, si tu te donnes un but, tu fais des efforts pour l’atteindre. Mais comme tu dévies, nécessairement, parce que tu n’avais pas pu tout prévoir, tu dois faire des efforts de plus en plus grands. Et tu as une conduite de moins en moins adéquate. Et tu te sors de plus en plus de toi-même.
P.– Eh ! bien, j’accepte difficilement. S’il faut s’arrêter à ses petits plaisirs en se moquant du reste du monde ! Mais, ça, c’est le rat retiré dans son fromage. Ce n’est vraiment pas dans mon tempérament.
H.– Non, parce que tu joues le personnage de la « Bonne Âme ». Ton tempérament, c’est de ne pas vivre. De t’empêcher de vivre. De t’user à des choses qui ne sont pas toi. Et c’est pour cela que toi et les tiens vous ne produisez rien. Ce qu’il faut c’est être créateur. Et vous n’êtes pas créateurs.
P.– Alors tu crois que je n’ai fonctionné que par rapport à des buts en dehors de moi. Tu crois que j’aurais accepté de passer par les fourches caudines du CEP. Tu crois que mon seul souci ait été d’imiter les grands personnages. Tu dis que nous ne sommes pas créateurs. Et pourtant toutes ces peintures, ces chansons, ces maths...?
H.– Mais ces peintures... Ce n’est pas vous qui avez été créateurs, ce sont vos enfants, c’est différent.
P.– Mais est-ce qu’il n’a pas fallu créer des conditions de liberté et d’organisation de la classe pour obtenir cela ?
H.– Ah ! oui, là, je suis obligé d’en convenir : vous créez une atmosphère. Vous créez des conditions d’épanouissement. Mais elles ne sont pas totales. Parce que vous êtes dans le système de répression. Vous n’êtes pas libres. Et vous ne pouvez pas libérer les autres par votre façon d’être.
P.– Pas libérer ! Écoute, Hervé. Tu sais, Joëlle, enfermée depuis deux ans dans son mutisme, elle parle maintenant. Et elle vient seule devant toute la classe raconter ses histoires de la famille singe. Et Jean-Paul, tu connais, le super-émotif. Eh ! bien, lui aussi vient raconter ses histoires irrésistibles de crocodile. Et Ginette, Denis, Rémi... Non, non, je n’accepte pas, D’ailleurs, tu les as vus.
H.– C’est vrai, je les ai vus. Je suis bien obligé d’admettre que tu crées un excellent climat et que tes élèves sont plus libres. Et peut-être que toi, tu t’es réalisé à 70%. Mais ce n’est pas le cas de tous tes camarades de l’École Moderne. Vous ne pouvez être des hommes libres puisque vous acceptez, ne serait-ce que les inspecteurs. Rien que cela déjà !
P.– Mais tu mets trop facilement tous les inspecteurs dans le même sac. Pourtant il en est au moins de trois sortes. Bien sûr, il y a les inspecteurs pourris d’autoritarisme et d’arrivisme. Je t’accorde qu’ils sont irrécupérables et qu’on doit faire front pour se faire respecter et rester des hommes. Ceux- là devraient commencer par se faire psychanalyser.
Mais il y a aussi la catégorie, mettons, des sportifs. Ceux qui ont voulu s’éprouver et juger leurs forces en passant l’examen. Qu’y avait-il d’autre pour ces gens qui n’avaient pas épuisé tout leur potentiel ? Rien. Alors ils ont pris cette filière par goût du risque et du sport.
Et enfin, il y a aussi ceux qui sont dévoués à l’enfance et qui ont pensé que pour obtenir le changement qu’ils désiraient, il fallait prendre ses responsabilités et accéder aux responsabilités. Et je t’assure que ces camarades ont fait changer beaucoup de choses. Mais je veux bien te concéder que l’espèce en est rare parce qu’ils ont été vite repérés.
Cependant on peut dire qu’il y a des inspecteurs qui sont des hommes et que d’autres peuvent le devenir ou le redevenir.
H.– Je veux bien te croire. À ceux-là, le chemin est tout tracé. Il faut qu’ils profitent de leur autorité trop facilement encore reconnue pour organiser le dialogue entre les instituteurs tout en se retirant à l’écart. Mais tu n’es pas si libre que tu veux bien le faire croire. En tout cas, une chose est certaine : tes collègues ne le sont pas. Et puis, si tu étais vraiment sans peur dans la classe, ton exemple permettrait aux autres de se sentir au même niveau de liberté que toi. Et tu n’es même pas libre dans tes articles. Tu fais des citations : tu n’oses même pas être toi-même.
P.– Écoute. Je te l’ai déjà expliqué. Je veux convaincre des intellectuels, je dois m’efforcer d’utiliser leur langage et leur façon de faire. Je pense qu’ils accepteront plus facilement de reconnaître leur accord avec une autre pensée que la mienne. Je ne veux surtout pas, moi vermisseau, avoir l’air de vouloir avoir raison. Je veux seulement qu’ils trouvent la vérité là où elle est.
Et puis, va, mon gars, conteste ton pauvre père ; ça te fait trop plaisir pour que je t’en prive. D’ailleurs, tu seras comblé, parce que j’ai l’intention de ne plus écrire afin de pouvoir être, comme tu dis.
H.– Mais tu peux bien être en écrivant. Tu ne te rends pas compte de ça ? Tu as un moment, toc, tu prends une feuille : tagadac, tagadac, tu écris un quart d’heure. Le soir, même chose ; à un autre moment, même chose. Mais s’asseoir et écrire deux heures de suite, non ça c’est de l’obligation, je n’y crois pas. Mais je crois qu’on peut être en écrivant. C’est de la création. En tout cas, ça vaut mieux que de penser à vide sans action. Et c’est une forme d’action. Mais méfie-toi d’une chose : du fait même que tu écris, tu n’es plus vrai quand tu écris. Et celui qui te lis reçoit quelque chose qui n’est plus vrai.
P.– Mais si ça l’aide à être vrai ? Pour ceux qui sont séparés de leurs frères, est-ce que ma spontanéité même fruste ne peut être utile et déclencher des spontanéités de même niveau ? Ou bien, faut-il me recentrer sur ma classe ?
H.– Ce qu’il faut, au sein de ta classe, c’est créer une communauté où l’on puisse vivre.
Et il faut peut-être aussi créer cette communauté dans votre mouvement. Et c’est peut-être parce qu’elle existait que votre mouvement a duré. Mais n’est-elle pas en train de se disloquer. Prenez-y garde. Ce serait dommage. Pour en revenir à ta classe, tu devrais être courageux et faire ce qu’il faut faire.
D’accord pour la création littéraire écrite s’épanouissant dans tous les azimuts. D’accord pour la création mathématique, la création orale, la création gymnique, musicale, etc. Mais va plus loin. Tu as vu le Living. Tu as vu Béjart. Tu sais que tout, dans la vie, vaut la peine. N’enferme tes enfants dans aucune impasse. Offre-leur la beauté des feuilles d’érable, le soleil clairsemé sur la pelouse, la rugosité du granit des Troïéros, le poli du rose de la Clarté, la fraîcheur du vent, le moelleux du sable pour les chutes, les rythmes d’un bruit de porte au veut, le troglodyte chantant... Mais ne les enferme pas comme Maman avec ses exigences de « peindre propre ».
P.– Tu sais : le maître a lui aussi besoin de réussir : c’est un être qui crée une classe. Avec cette discipline, dans le cadre d’avarice totale de l’État, quelque chose est possible. Et chacun des vingt-cinq enfants de la classe peut trouver des couleurs propres. L’essentiel c’est de partir. Il faut que le maître prenne le départ, les enfants aussi. Ils aboutiront alors à leur heure, à la peinture « viscérale » dont tu parles.
H.– C’est vrai : les possibilités de création sont bien limitées par la société. Et vous devez vous débrouiller. Mais ce n’est qu’un pis-aller. Sur le plan oral, il faut tout accepter. Et là, justement, rien n’empêche d’atteindre à la création viscérale. Les cris, les plaintes, les onomatopées, les mots sans suite, on en fait des concerts, des festivals. Pourquoi n’y aurait-il pas ce festival dans ta classe, ce festival de vie, de création, d’existence. Et en gym, en danse, en chant, les chemins sont infinis, le sais-tu ? Maintenant, avec tout ce que l’on a découvert un peu partout dans le monde, il n’est plus possible de lier les enfants dans les langues des stéréotypes d’autrefois et de vouloir faire leur bien malgré eux, contre eux.
P.– À qui le dis-tu ?
H.– Je sais. Mais tu ne seras pas un homme si tu n’oses être. Et si tu ne le dis à tes camarades perdus dans des systèmes périmés de connaissances à acquérir, de programmes à remplir à la force du poignet, de certificats à passer qui n’existent que pour vous donner des raisons d’exister. À tes camarades, de peur paralysés, et qui ne voient pas que s’ils n’avaient pas peur, leurs élèves en sauraient beaucoup plus, même dans le domaine des connaissances et des techniques qui les angoisse tant.
P.– Oui, oui je t’entends. J’essaierai. Je serai.
H.— Mais pourquoi du futur ? Pourquoi pas dès maintenant je suis ?
Paul Le Bohec
Article paru dans l’éducateur n°1, sept-oct 1968, p.41