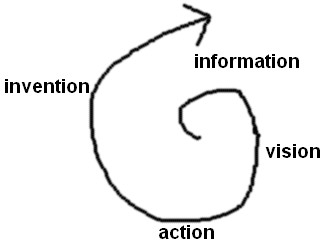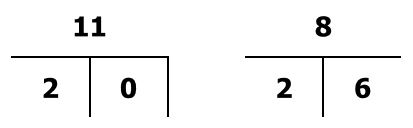L’année dernière, dans ma classe, je me suis livré à une expérience d’« expression mathématique libre ». Je viens d’en rédiger le compte rendu pour les « Documents de l’Institut Freinet » (1). Mais ici, dans l’Éducateur, j’aimerais pouvoir exposer des réflexions autour de cette expérience.
Car – je m’en suis aperçu aux Journées de Vence – elle a le privilège de susciter beaucoup de discussions. Or, je pense justement qu’il est grand temps d’ouvrir, à propos de mathématiques, un débat sur le fond.
Évidemment, je ne prétends pas avoir raison à 100%, ni même à 99%. Mais j’ose avancer que certaines pratiques pédagogiques actuelles me semblent assises sur des conceptions périmées. Si j’ai tort, cela se saura vite. Si j’ai raison, il faut que nous nous remettions à l’heure.
Et, puisque la relation des circonstances de mon expédition mathématique au CE1 fait se lever des vagues, profitons-en au maximum pour engager à fond les fers.
BUTS DE L’EXPÉDITION
Depuis un certain nombre d’années, une conviction s’était solidement ancrée en moi : on peut commencer très tôt la formation mathématique des enfants.
En cherchant avec mon garçon et ma fille, je m’étais aperçu que des notions habituellement réservées étaient parfaitement accessibles à de jeunes enfants. Trois années d’expériences dans ma classe m’avaient confirmé dans cette opinion. C’était des expériences sans danger puisque, portant sur les systèmes non-décimaux, elles aboutissaient en fait à une pratique de la division. Loin de nuire au calcul, elles entraînaient au calcul. D’autre part, l’introduction accidentelle des inconnues (souvenez-vous : ces choses inconnues que Guy appelait au début « Be le be le » ; 5 Be le be le + 4 Be le be le = 9 Be le be le, et que l’on appela par la suite : i, a, w, k, x), m’avait ouvert une autre piste. Et elle avait apporté des réponses affirmatives à mes interrogations sur les possibilités réelles des enfants.
Aussi, en ce début d’année 65-66, je me sentais mûr pour une nouvelle expérience à un niveau plus généralisé.
Ainsi, j’étais persuadé qu’une pédagogie des mathématiques était possible dès les premières années de l’enseignement primaire.
Mais, pour moi, il ne pouvait s’agir que d’une pédagogie Freinet. En effet, vingt-quatre années de la pratique de cette pédagogie m’avaient permis d’assimiler un certain nombre de ses principes. Et j’éprouvais une fois de plus le désir de les appliquer.
L’un de ces principes, c’est l’unité de la personne humaine. Il commande, nécessairement, l’unité de la pédagogie. Aussi, c’est à bon droit que je me posais des questions : pourquoi les mathématiques feraient-elles bande à part ? Pourquoi échapperaient-elles au tâtonnement expérimental ? Pourquoi n’y aurait-il pas une technique d’expression mathématique libre ?
Pour obtenir des réponses à ces questions, le mieux n’était-il pas d’y aller voir ? Or, il se trouvait que je n’étais pas totalement désarmé. En effet, j’avais eu la chance de pouvoir pousser assez loin une expérience de littérature enfantine au CP-CE. Et, d’autre part, j’avais pu suivre de très près une expérience d’art enfantin au même niveau.
La confrontation de ces deux expériences profondes réalisées sous la direction d’Élise Freinet m’avait permis de progresser sur le plan théorique. Une première application de cette théorie aux techniques parlées, au chant libre, à l’éducation physique m’avait valu des résultats très intéressants. Pourquoi ne pas étendre cette application aux maths ?
Dans ce domaine totalement nouveau, pour ne pas dire saugrenu, j’étais certain de pouvoir tester valablement nos conceptions psycho-pédagogiques. Qui donc, mieux que les maths, auraient su y résister ? Là, mieux que partout ailleurs, il était possible de comprendre les excellences et les insuffisances de notre pratique pédagogique. Et cela devait nous permettre également, si nous savions tirer convenablement les leçons de l’expérience, de passer rapidement à un niveau d’affinement supérieur de notre théorie. Qui saurait résister à une telle perspective ? Pas moi, dit le dindon.
Donc : mathématique au premier degré, mais : mathématique « Freinet ».
En outre, depuis un lustre, il n’était bruit que de mathématique moderne. Nous devions obligatoirement y aller voir. Mais si le problème de la reconsidération de l’enseignement de cette discipline se posait en entier, les solutions qu’on y apportait dans les hautes sphères nous laissaient sur notre faim. Partout, il n’y avait que des premiers pas : les professeurs les plus qualifiés se heurtaient, au niveau des petites classes, à des difficultés en apparence insurmontables. Ils semblaient bien connaître le latin, mais ils paraissaient mal connaître John. Or, nous, c’était plutôt le contraire. Aussi, je pensais secrètement, avec un sourire en biscancoin, que l’équipe Freinet pouvait aider à débrouiller l’écheveau et à trouver un premier bout de fil.
À mon avis, il ne faut pas s’affoler, il faut rester calme devant la mathématique moderne. Quand elle nous propose une idée intéressante, une solution satisfaisante, il faut l’accepter. Pourquoi la refuserions-nous ? Mais, faut-il, à toute force, se mettre à son service et s’en coiffer comme d’un bonnet ?
Cependant, je dois dire en toute franchise qu’elle éclaire, ordonne, simplifie, enrichit. Et si André Revuz a donné pour titre à l’un de ses livres : Mathématique moderne, mathématique vivante, je crois que, de notre côté, nous pourrions écrire : Mathématique vivante, mathématique moderne. On le voit, c’est commutatif.
Mais cela, je ne le savais pas au départ. Le but de l’expédition, c’était seulement « Étude des possibilités de la pratique d’une pédagogie « Moderne » des mathématiques à l’école primaire ». Cela aurait déjà suffi à me mettre en marche. Mais il se peut qu’à l’origine j’aie eu d’autres desseins informulés. Et, d’autre part, je n’excluais pas la possibilité de l’apparition de nouvelles idées en cours de route : sans chercher, je pouvais trouver.
Cependant, je puis dire, dès maintenant, que, pour une fois, je suis resté assez longtemps fidèle au programme que je m’étais tracé. Et s’il y eut déviation, ce ne fut qu’en fin d’année, lorsque j’eus acquis quelques bonnes certitudes.
PRÉPARATION DE L’EXPÉDITION
Puisqu’il s’agit d’éducation, il faudrait examiner successivement : l’éducateur, les éduqués, les moyens de l’éducation, les conditions de l’éducation. Je ne sais si j’aurai la force d’aller jusqu’au bout de cette exigence. Mais voyons tout d’abord :
L’ÉDUCATEUR
Pourquoi donc commencer par lui ? Parce que c’est lui qui est à l’origine de tout changement de méthode ; c’est lui qui en ressent l’impérieux besoin, c’est lui qui le réalise ?
Heureusement, je puis parler en toute liberté de l’éducateur, car la vie m’a donné la chance de pouvoir parler de moi sans complaisance ni retenue exagérées. Évidemment, on pourra me taxer d’exhibitionnisme. Pourtant, lorsqu’on veut examiner la question de l’enseignement sous tous ses angles, on ne peut négliger la personne même de l’éducateur. Ici, il fallait bien que certaines conditions psychologiques soient réunies pour que j’ose entreprendre cette expérience.
Il faut bien le dire, mon enfance m’a doté d’un certain équilibre psychologique. L’origine paysanne de mes parents, le métier de mon père, la vie calme d’un faubourg du pays gallo, tout cela a contribué à me doter d’une absence remarquable de complexes. J’ai donc une grande liberté personnelle, une aisance de mouvement. Je le souligne peut-être lourdement, mais je suis persuadé que la liberté du maître est un facteur important de l’éducation. Et lorsqu’on voudra progresser dans ce domaine, il faudra se soucier de la développer. Cela paraît d’ailleurs très facile à réaliser. D’autre part, à 13 ans, j’ai subi un choc : j’ai été placé « en pension » à 80 km de notre foyer. Et, quand on nous avait séparés, mon jeune frère de six ans se laissait traîner en criant sur le quai de la gare. Depuis, je crois que je n’ai plus grandi : je suis resté au niveau des enfants ; je ressens très profondément tout ce qui les atteint. Je me sens l’un d’eux. Je suis leur porte-parole et je me sens responsable devant eux. Et, pour défendre leur cause, j’ai tout un arsenal de becs, de griffes, d’ongles, de dents et de colères.
Or, j’ai pleinement conscience que, avec l’orthographe, le calcul est l’un des instruments privilégiés de l’oppression des adultes. Il faut engager la lutte sur ces deux fronts.
Pour ce qui est du calcul, on peut facilement satisfaire à la demande adulte qui est en passe de devenir anachronique. Il faut démontrer aux adultes qu’il est possible de faire beaucoup mieux ; dans la détente, et non plus dans l’angoisse. Cette conviction est si profondément ancrée en moi qu’elle m’arme de tous les courages. En vérité, réellement, je ne crains plus rien, ni personne. Et je suis prêt à foncer dans tout obstacle qui oserait se présenter. Du côté des parents, je n’ai rien à craindre. Que demandent-ils en effet ? Des cahiers propres et, si possible, bien écrits, de la lecture et de bonnes opérations. Si je mets en place ce paravent à trois vantaux, on me laissera tranquille ; on ne m’empêchera pas de travailler vraiment, c’est-à-dire en profondeur. Et puis, cela fait dix-huit ans que je suis dans la commune ; je commence à être un élément du paysage. D’ailleurs, en général, les parents et moi, nous avons de bonnes relations. Mon intérêt pour leurs enfants n’est pas factice, le leur non plus : il y a une intersection.
Et le monde moderne, et l’avenir, les inquiètent suffisamment pour qu’ils acceptent de croire que je pourrais peut-être avoir aussi raison.
Mais j’ai tout de même peur de quelqu’un. Et j’ai beau courir ou me cacher, je ne peux lui échapper. Oui, j’ai peur de moi-même. En effet, quand je me lance ainsi, suis-je toujours assuré de réussir ? Le bénéfice de l’opération sera-t-il nécessairement positif ? Je l’espère toujours au départ, mais je n’en suis jamais certain. Et puis, le problème du droit aux expériences ne se pose-t-il pas ? Bien sûr, je pourrais prendre à loisir toutes les libertés que je voudrais. Mais, en éducation, le premier devoir n’est-il pas de ne pas nuire ?
Or, quand on se lance dans l’inconnu, est-on jamais certain d’avoir totalement raison ? Et cette marge d’incertitude ne suffit-elle pas pour qu’aussitôt un contradicteur vienne s’installer en moi. Il est irresponsable ; mais il voudrait m’accuser d’irresponsabilité. Et ses critères ne sont jamais les miens. Il se place nécessairement dans l’optique de l’ancien programme. Et moi, dans celle d’un nouveau programme malheureusement encore à constituer. Mais ça ne dure pas longtemps : tout de suite, j’éclate.
Car, dans sa vertueuse moralisation indignée, mon contradicteur oublie candidement de considérer que, si l’on peut nuire aux enfants en faisant des expériences, on peut aussi terriblement leur nuire en n’en faisant pas.
De quoi s’agit-il en éducation ?
De favoriser l’adaptation d’un être humain à la société moderne, c’est à-dire d’insérer un être qui change dans un monde qui change considérablement et qui changera encore plus. Il est évident que pour réaliser cela, les « bonnes vieilles techniques éprouvées » ne conviennent plus. D’ailleurs la faillite d’une éducation qui n’a pas su se renouveler est aujourd’hui patente et partout reconnue.
Et puis, même quand on prétend le contraire, on fait des expériences. Par exemple, celle de la résistance d’un matériau. Ce matériau est usiné pendant vingt à vingt-cinq ans. Au bout de vingt-cinq ans, il est parfait. Et l’on se pose la question :
« Savoir si cette pédagogie que j’ai mise au point va pouvoir résister trente années aux guerres, aux changements sociaux, à l’évolution économique, à l’évolution des idées, au progrès des connaissances, à l’intensification des échanges intellectuels, à la modification des buts de l’éducation, et à mes propres transformations ? »
Et quand, après trente années, au bout de l’expérience, on s’aperçoit qu’elle a résisté à toutes ces épreuves, on peut se dire :
« Vraiment, elle était solide. »
Oui, cela je le savais au départ : pour adapter, il faut bien changer. Mais c’était une connaissance qui se situait seulement au niveau de la raison. Tandis que les antiques conceptions étaient inscrites en moi plus profondément, organiquement pour ainsi dire. En fait, il me fallait changer de technique de vie. Et l’on sait combien cette sorte de mue est douloureuse et difficile.
Aussi fallait-il que je tente de me libérer de mon angoisse personnelle. C’est pourquoi je décidai de ne travailler ainsi qu’au CE1, avec des enfants qui, au CP, avaient fait des bandes enseignantes et qui, de ce fait, avaient en gros dominé plus de 50% des difficultés du calcul. Ce qui, par conséquent, me libérait de plus de 50% de mes soucis. Au fond de moi-même, j’espérais que j’allais tout de même obtenir encore certains résultats en calcul et que les dégâts ne seraient pas considérables, même au point de vue strict de l’ancien programme.
Pour plus de sécurité, je décidai de fixer Pâques comme limite à mon expérience. Je pensais que j’étais suffisamment maître de cette classe (vingt-cinq années d’enseignement) pour pouvoir rétablir complètement la situation au cours du troisième trimestre.
Enfin, de mes neuf anciens CP j’éliminai provisoirement un garçon très jeune et peu mûr qui pouvait être un motif supplémentaire d’inquiétude. Je le mis aux boîtes enseignantes.
Toutes ces précautions étant prises, je pouvais être très détendu. Et il le fallait, puisque je tentais une expérience d’expression libre : il fallait que le maître et les enfants disposent d’une liberté aussi grande que pour les autres techniques d’expression. (Tout camarade qui voudra tenter une expérience semblable devra lui aussi se rendre libre, ne serait-ce qu’un jour par semaine, une semaine par mois, un mois par an, etc. en attendant que cette liberté devienne le pain quotidien des journées.)
Oui, vous venez de le voir, le maître a su prendre toutes les précautions nécessaires à la suppression de son angoisse personnelle.
Mais à une angoisse en succède immédiatement une autre. En effet, sur le plan des mathématiques, que valait le maître ? Était-il bien préparé à sa tâche ? Avait-il le droit de se lancer avant d’avoir bien dominé le sujet ?
Oh ! Oui, je pouvais être angoissé, là aussi. C’est vrai : qu’est-ce que je valais ? J’ai toujours été un matheux moyen. 13,5 sur 20 au B.S., c’est vous dire. D’ailleurs cette préparation de l’École Normale remontait à l’an quarante. Elle ne pouvait suffire. D’autre part, sur la route que je suivais, je me trouvais bien seul à l’École Moderne. Et je n’avais guère à attendre d’aide des camarades, aide pourtant habituellement si efficace.
Par chance, pour la mathématique moderne, Puynège me mit en relation avec Sadin, de l’Isère. Et, entre nous trois, pendant une année, circula un cahier de roulement qui me permit d’assimiler un certain nombre de notions.
Et puis, je suivais régulièrement les émissions Chantiers mathématiques à la télé. Bien sûr, elles me passaient par-dessus la tête, mais, comme elles étaient destinées aux professeurs du second degré, je ne faisais aucun complexe. Le fait que je n’étais pas tenu de comprendre me détendait. Et cela facilitait parfois ma compréhension. Parfois, je m’endormais ; mais le plus souvent, même si je ne comprenais rien, je m’amusais des duels Guilbaud-Revuz ou Walusinski-Revuz. Et je prenais parti pour l’un ou pour l’autre ; généralement pour celui qui, par une rapide allusion au réel, me permettait de tenir la tête hors de l’eau, une seconde de plus. Je participais donc affectivement, ce qui est excellent pour la fixation des connaissances. Le spectacle à ce niveau valait la peine d’être vu : un duel de virtuoses, c’est toujours beau à voir, même quand on est très profane.
Lorsque j’avais tout de même réussi à saisir une notion qui passait à ma portée, je l’offrais à mes élèves à la première occasion. Et ceci m’a permis de prendre conscience d’une réalité dont je voudrais informer les camarades prêts à se lancer dans le bûchage forcené.
De quoi s’agit-il ? S’agit-il de progresser en mathématique ? Non, il s’agit de progresser en pédagogie des mathématiques. Or, on peut s’inspirer de A. Revuz qui écrit :
« On ne peut lire un travail mathématique sans refaire soi-même les démonstrations ; l’étude est une véritable lutte avec l’auteur qui n’est présent que par son œuvre dont il s’agit de mettre la solidité à l’épreuve. »
Oui, il est impossible de lire un livre de maths, comme on lit un roman. Sinon on en resterait uniquement au stade de l’information : on ferait la planche. Si l’on veut progresser, il faut avoir une attitude active : il faut nager.
En pédagogie des maths, il en est de même. Certes, on peut lire des livres – ou ce compte rendu – assister à des journées pédagogiques, participer à des stages, des congrès. Mais si on ne veut pas rester au stade de la simple information, si l’on veut passer au stade de la connaissance intégrée, il faut avoir une attitude active.
En pédagogie, c’est avec les enfants qu’il faut éprouver la solidité des idées pédagogiques. Mais il se trouve que, ce faisant, le maître peut également retirer un grand profit sur le plan de la connaissance mathématique. J’en donne un exemple :
Dans les revues, brochures, livres, cahiers, j’avais été amplement informé au sujet de la notion de relation. À force de lire dix fois, vingt fois cette information, je commençais à bien en connaître la formation. Mais quand elle est apparue dans ma classe, c’était tout autre chose : elle avait une saveur, une couleur, une odeur, elle avait les caractéristiques de la réalité. C’est que, cette fois, elle était chargée affectivement : je savais quel enfant l’avait amenée, quel enfant avait réagi, quels enfants l’avaient modifiée, prolongée, élargie. Aussi, je l’intégrais pleinement en une fois, en m’étonnant que cela ne se soit pas fait plus rapidement. Oui, je peux dire que ce sont les enfants qui m’ont permis de la vraiment saisir.
Mais pourquoi s’en étonner : il s’agit de notions nouvelles et non d’un acquis que j’essaie de transmettre par voie d’autorité ; comme je ne sais rien puisque je n’ai pas encore « agi » ma connaissance, je fais partie de l’équipe de chercheurs, je bénéficie de ses progrès : je suis, moi aussi, en marche ; avec l’équipe je me pose questions sur questions. Et voilà ce qui est l’essentiel :
« S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit… C’est qu’il ne s’agit pas d’avoir « l’âme professorale » mais « l’âme en mal d’abstraire et de quintessencier, la conscience scientifique douloureuse. » Bachelard, la formation de l’esprit scientifique
Et comme les enfants ont des trouvailles constantes, ils me bousculent continuellement et leurs angles de vue originaux me surprennent et me permettent par ma plus grande ouverture d’esprit et les recoupements successifs que je puis faire, une meilleure appréhension des choses.
Oui, s’il est bon d’être informé au préalable, la vraie connaissance ne saurait provenir que d’une action. Pour les maîtres, le profit sera double puisqu’il sera pédagogique et mathématique. C’est même leur chance d’avoir avec les enfants une si forte catalyse affective.
Quand je dis que j’étais au niveau de mes enfants, j’exagère, évidemment.
Pour beaucoup de choses, tout de même, j’étais en avant. Et, à cause de cela, je pouvais jouer un rôle essentiel au progrès du groupe : le rôle de critique. Par des questions, des ignorances réelles ou simulées, des silences dubitatifs, je pouvais aider aux prises de conscience.
Mais qui jouait pour moi le même rôle ? Évidemment, j’avais le «Papy» et d’autres livres qui s’efforçaient de répondre à mes questions. Mais leur critique était difficile à discerner.
Par chance, je disposais sur le plan familial de quelqu’un : mon garçon, qui est en propédeutique (M.P.C.) à Brest. Aussi je pouvais lui soumettre mes petites découvertes. Et la réponse à mes interrogations était très bien assimilée parce que j’avais une bonne ouverture de question et une bonne fermeture de réponse.
Je précise ce point particulier et important de la post-information pour montrer que lorsqu’on dispose dans les environs immédiats d’un camarade de recours, ou peut se lancer. Et chacun verra que c’est dans la foulée de l’action mathématique que l’on assimile le plus parce que c’est à ce moment que l’esprit est le plus ouvert.
(à suivre)
Paul Le Bohec
Texte paru dans l’éducateur N°7, la part du maitre, 1er Janvier 1967, p.11-18
(1) « Documents de l’Institut Freinet », Publication interne du mouvement Freinet